CHRONIQUE
COULEUVRES ET LAPINS
Ce Dimanche, je devais recevoir trois visites :
Alexandre Del Valle, un courageux et talentueux spécialiste de l'Islam passionné par l'équilibre des forces et des idéologies qui broient les populations,
Pierre Seznek un ambitieux qui cherche frénétiquement à étendre son réseau de relations en Russie et son amie. Sezneck chante magnifiquement et a le don rare d'attirer à lui les plus somptueuses - et admirables - créatures. Sa dernière amie allie une beauté éblouissante à une vive intelligence et un charme irrésistible. En définitive, elle s'est décommandée, puis hier au dernier moment cela a été le tour de Pierre lui-même. Des lapins...
Cette semaine, le jeune homme dont il a été beaucoup question, dans ces derniers billets, m'a posé, lui, des lapins téléphoniques. Cela va plus loin, d'ailleurs car il s'est froidement assuré que je ne pourrai me dégager de son emprise, en me tendant un piège, puis en me faisant avaler des couleuvres. J'en ai beaucoup souffert, et il le sait.
C'est la même attitude méprisante qui, par mimétisme sans doute, affecte mes relations avec une de ses employées les plus efficaces, que j'ai pourtant aidé de mon mieux auprès de son patron. J'avouerai que je n'en fais pas grand cas, car cela dissipe les illusions que je pouvais nourrir sur cette femme intelligente qui s'est révélée une arriviste au petit pied.
DERNIERE MINUTE
Alexandre del Valle n'est pas venu! L'erreur ne vient pas de lui, le pauvre, mais de Pierre Seznek, qui a omis de l'avertir qu'il ne pourrait pas le véhiculer dans sa voiture, et n'a pas non plus jugé bon de m'avertir. Enfin, il faut de tout pour faire un monde, et il faut se fier à l'infiabilité de certains individus. Comme le dit Brecht,
comme on fait son lit on se couche, si quelqu'un doit crever, c'est toi !
Marina et Jean-Marie, avaient préparé un succulent repas pour Del Valle et nous devrons le consommer demain, si nous sommes toujours à Deauville, car il est possible que je parte à Paris. C'est demain en effet que je saurai à quelle sauce je serai mangé et quand je serai opéré, si l'opération est possible. Ils se sont tous donné beaucoup de mal. Socrate voulait m'emmener en Israël où il connaît les meilleurs chirurgiens, mais ici, j'ai des attaches, je ne suis pas un numéro pour le Professeur Paul. Je me souviens que Sergei Pugatchev ne jurait que par un procédé censé vous guérir instantanément. Il suffisait d'appliquer le principe selon lequel une très forte fièvre tuait les virus. On vous portait le sang pendant quelques instants à une température non pas de 40° mais de 60°. Certes on avait de fortes chances d'y laisser la peau, mais avec la satisfaction de tuer cette saloperie de virus!
J'en serai quitte pour aller au cinéma, ce qui m'arrive une fois par an ! Dans le corps du billet j'ai l'intention de transférer mes impressions sur Stefan Zweig, dont je viens de lire "Les vingt quatre heures de la vie d'une femme".
EN LISANT THOMAS MANN
J’ai pratiquement lu tous les livres d’un des deux plus grands romanciers allemands de ce siècle, avec Thomas Mann, ami de Stefan Zweig.
Tout oppose les deux écrivains qui connurent l’exil, l’un au Canada, au Château Frontenac de Quebec, l’autre , après bien des tribulations, dans une petite ville du Brésil. Où avec sa femme, il se donna la mort pendant que la chape nazie se faisait de plus en plus lourde dans son Europe bien-aimée.
Je fus fasciné par le « Docteur Faustus », que je lus en un Week-End loesque j'avais à peine vingt cinq ans. Cet énorme ouvrage se déroule en deux temps superposés.
Le premier, mis en abîme, conte la vie du compositeur Adrian Leverkühn, vue par son biographe et famulus dévoué, Sérénus Zeitblom. Adrian, doté d’une intelligence surhumaine, exaltée par la syphilis, (comme Robert Schumann) a vite fait le tour de la musique de son temps, qui n’offre aucune novation depuis mille ans, toujours ancrée da système tonal ou polytonal. Il tourne en rond, en essayant d'échapper à la routine générale, échoue, et finit par donner son âme au diable si celui-ci lui permet de trouver une nouvelle voie radicalement novatrice. Le jour convenu, Méphistophélès réclamera son dû.
La nouvelle voie n’est autre que le dodécaphonisme mis au point par Arnold Schönberg, sur les conseils de Theodor Adorno.. Schönberg, furieux de se voir comparé au diable, intenta un procès à Thomas Mann. Mais ce qui est important a été la description du grand oratorio de Leverkuhn : « Apocalypsis cum Figuris », d’après les bois d’Albrecht Dürer. A la lire, on jurerait qu’il s’agit d’une analyse très détaillée de la plus grandiose des œuvres jamais composées. Cette oeuvre fictive semblait plus vivante, plus réelle que de bien d'autres pourtant connues, comme celles de Richard Strauss.
Ce faux compte rendu me plongea dans un état de frustration indicible. Comment une œuvre pareille n’a-t-elle pas été réalisée ? Pourquoi en cette ère de fin d’un monde si ce n’est du monde, aucun musicien, doté des moyens acoustiques et électroniques les plus sophistiqués, complétant une formation orchestrale géante, n’a pensé à écrire un oratorio sur l’Apocalypse de Jean? A la rigueur on peut évoquer l’Apocalypse de Pierre Henri, injustement méconnueutilisant la musique concrète, c'est à dire composée d'échantillons de bruits divers, manipulés par ordinateur. Mais elle exige des moyens immenses. J’ai eu la chance de l’écouter à la première, à l'ex. Théâtre de la Gaîté, square Louvois, face au Département de la Musique de la BNF., là où reposent mes documents et mes partitions.
Aussi étrange que paraisse, l'oeuvre qui s’apparente le plus à l’Apocalypse de Leverkuhn est la fugue de la « Hammerklavier , Op.106 » de Beethoven. Elle présente en effet la même macrostructure. Dans l’Apocalypsis cum Figuris de Leverkühn, , une musique de plus en plus chaotique et infernale, combinant toutes les ressources de la polyphonie dans un manège giratoire infernal, s'arrête net au centre de l’oratorio.

Ci-dessus, même si vous ne savez pas lire les notes, voyez le dessin. Des sauts de rires démoniaques s'achèvent par une chute de croches péremptoire, comme pour dire : je n'en peux plus ! J'ai trop ri et je suis essoufflé. Ce n'estr évidemment qu'une évocation.
Il se fait soudain un grand calme.

Ci-dessus, une fuguette dans le style détaché de J.S.Bach, introduit une aire de paisxfactice, oeil du cyclone. Les notes sont toutes égales comme dans un plain-chant.
On contemple une cohorte d'anges planant sur le miroir d’un étang gelé. La voix des anges est lointaine, détachée, séraphique et semble quelque peu indifférente au sort des humains.
Et voici : bientôt des vers immondes sortent de leurs narines, la pourriture gicle de leurs oreilles… et avec effroi on constate que le chant des anges n’est qu’une transposition rigoureuse à quelques changements de paramètres près du thème de la polyphonie de la Bête.

Ci-dessus, le thème tranquille de la fuguette dans le style deJ.S. Bach est de plus en plus pénétré par les doubles croches serpentines de la fugue.
Je vous ai déjà conseillé l’interprétation de Kempff sur DVD. Elle est indispensable, mais vos yeux risquent de vous distraire de la musique. Il faudrait alors opter pour la version de Backhaus, « live » au Carnegie Hall en 1955, ou pour celle de l'intégrale d’Arthur Schnabel. Cette fugue géante est composée d’un sujet en forme de serpent : la tête d’abord, puis deux spires, enfin tout le corps qui s’engage, sujet trituré, traité de toutes les manières possibles, dont la forme rétrograde, effroyable, dans laquelle le temps se déroule à rebours. Le serpent déroule ses spires du futur vers le présent. Les deux formes régressive et correcte se rencontrent fréquemment à mi-chemin.
Et voici : la fugue semble conclue sur des rires inextinguibles, affreux, hystériques lorsqu’un grand calme s’établit. (voir les exemples commentés ci-dessus) On entend alors une seconde fugue, chant paisible, dans le plus pur et le plus angélique style de J.S.Bach, mélodie condescendante et glacée, presque fondue dans une méditation venue d’ailleurs.
C’est alors que peu à peu le thème de la fugue infernale corrompt le chant séraphique, qui bientôt laisse apparaître son effrayant martèlement, comme d’immenses enjambées, débouchant rapidement sur la fugue principale. Celle-ci a rompu tout lien avec une forme raisonnable. Le corps du serpent est tronçonné en fragments déformés hideusement, saisis de convulsion spasmodiques. Comment ne pas comprendre le pauvre Julius Katen, qui disait que Beethoven eût mieux fait de ne pas l’écrire. Bien des critiques disent avec raison que l’œuvre n’est pas belle, voire monstrueuse. Mais Picasso avait déclaré qu’il préférait peindre des monstres plastiquement satisfaisants, que des sujets plastiquement agréables mais plastiquement monstrueux.
La fugue se termine par une sorter de tremblement de terre qui ébranle tout l’instrument, et finit sur des déhanchements rythmiques tellement ardus à réaliser que Schnabel qui les préconise dans son édition de travail, est bien incapable (comme tous les autres grands pianistes, sans exception) de les exécuter et que les éditions studieuses pour les élèves de conservatoire, oblitèrent comme chose gênante ou accessoire.
Voici une version courante.

Ci-dessus vous remarquerez les spires descendantes du serpent que l'on peut comparer à une chute vertigineuse. S'ensuivent six trilles tous identiques dans un mouvement ascendant. Identiques parce que chacun se termine par des doubles croches ornementales (en petits caractère).
Or vous devez savoir que le manuscrit original de la 106 s'étant égaré, on ne dispose que de trois éditions originales parues simultanément à Londres, à Vienne et à Paris. Il se trouve que dans notre collection de partitions, en dépôt à la BNF, se trouve l'édition de Paris et celle de Vienne, c'est à dire la version qui fait foi. Or ainsi que Schnabel le fait remarquer dans son édition de travail, que Beethoven a omis intentionnellement de noter les doubles croches d'enjolivement dans les deux premiers trilles, il n'y a que les deux troisièmes trilles qui le conservent. Mais il y a mieux. Les qautre mesures ne doivent pas sonner comme 3X4 groupes, mais comme 4X3 groupes, ce qui entraîne un déplacement rythmique fascinant.

Ci-dessus l'édition originale correcte. Exercez vous à reconnaître la différence entre chaque trille et le déhanchement des figures de trois accords par rapport aux barres de mesure.
Malheureusement il y a un problème : aucun pianiste ne peut éxécuter ce passage ! Trop difficile ! On a fait remarquer qu'avec le temps, en matière sportive on bat sans cesse des records, la technologie devient de plus en plus sophistiquée, mais un passage comme celui-ci reste troujours aussi inaccessible ! La difficulté n'est pas seulement digitale, elle est également mentale.
Je vous disais que « Le docteur Faustus » se déroulait sur deux temps distinct. Le premier retrace la vie et la mort de celui qui donna son âme au diable et dont la dernière oeuvre se nommait « Le Chant de douleur du Docteur Faustus » Après l’avoir terminé et au moment de livrer son dû à l’Autre, le compositeur rassembla tous ses amis autour de lui pour qu’ils assistent à minuit à sa damnation. Et c'est à minuit, qu'il poussa un cri déchirant et tomba dans le coma. Il survécut ainsi : fin affreuse, corps vivant , âme morte.
Mais ce récit qui s’étend sur plusieurs décennies pour aboutir à peu près au présent du narrateur est mis en abîme. Sérénus Zeitblom, assiste en effet aux derniers soubresauts de l’Allemagne nazie, nation ayant donné son âme au diable, si bien que lorsque par année par année la vie de Leverkuhn est détaillée par le menu, elle se superpose par le récit tout aussi minutieux de la chute de l’Allemagne, semaine par semaine. Ceci ne donne qu’une petite idée de la complexité préméditée de l’architecture du roman. Sa lecture est rendue très ardue par l’amoncellement d’érudition, la longueur des phrases, un manque net de concision.
J’ai lu de Thomas Mann la saga des Buddenbrook que je n’ai pu finir tant le texte était prolixe, « La Montagne magique », « L’Elu » , pseudo médiéval, est des nouvelles brèves mais passionnantes, dont « Mario le magicien » et « Les Têtes interverties » histoire à la coloration bouddhiste.
Cette dernière nouvelle raconte comment l’esprit régente le corps. Désireuse d’obtenir le mari idéal, une princesse demande à la divinité de doter son époux malingre du corps splendide de son amant. Ce dernier héritera d’un corps débile habité par une intelligence médiocre. Au fil des années, il se passa que le corps de son mari s’étiola et finit par regagner son apparence maigrichonne. Au contraire, son amant s’exerça de telle sorte, que son corps se transforma et reprit sa splendeur antérieure. L’opération d’interversion des têtes avait été inutile. Bien sûr je raconte tout cela à ma façon, car cela fait bien quarante ans que je n’ai lu la nouvelle.
La concision et la portée générale de « Les têtes interverties » apparentent la nouvelle symbolique de Thomas Mann à ce qui fait de Zweig un des plus grands écrivains allemands : la concentration des idées dans le minimum de place, avec le minimum de mots, la pénétration profonde des mécanismes de l’âme humaine.
EN LISANT STEFAN ZWEIG
Stefan Zweig peut être considéré à la fois par sa vie et son œuvre, la vivante antithèse de Thomas Mann. Ce dernier ne peut se départir d’un langage référentiel, accumulation de fiches et rappelant Umberto Eco, le génie en plus. Zweig au contraire emploie un langage vernaculaire ce qui n’est pas antinomique de raffinement, comme Dante l’a prouvé. Les romans, biographies et nouvelles de Zweig font preuve d’une force d’expression des tréfonds de l’âme humaine, qui font défaut à son ami Thomas Mann. Lorsque l’on commence un livre de Zweig, on est aussitôt pris sous le charme et il est difficile de ne pas continuer jusqu’au bout son texte, généralement très coulant et court.
Contrairement à Jerzy Kosinski qui pratique un langage aussi concis, aussi parfait, mais volontairement impersonnel , ce qui frappe dans Zweig est l’exceptionnelle empathie qui le lie à ses personnages, et prend à témoi le lecteur, la profonde compassion, la chaleur complice qui se dégage de l’assemblage apparemment simple des mots et des phrases. Par ailleurs aucun romancier, même pas Proust, pourtant orfèvre en la matière, n’a su explorer de manière aussi fine, aussi subtile et aussi juste, les ressorts les plus cachés de l’amour et de la haine, de la passion et de la veulerie.
Parmi les romans de Zweig, il en est de relativement simples, comme les biographies de Marie-Antoinette, ou de Fouché, demeurées des modèles du genre. Mais quelques romans vont plus loin que d’autres, car il explorent par l'intermédiaire de créatures imaginaires les passions fatales de certains personnages, ou de certaines époques prédestinées. On côtoie, et quelquefois on dépasse, l’extrême, on dit l’indicible, on se meut en eau trouble comme un sous-marin à la recherche de quelque épave sombrée dans les abimes.
Je citerai volontiers des romans dépeignant une obsession, comme "Amok", ou une ressusscitant une époque exaltante et son retentissement sur certains esprits supérieurs , comme la période Elisabéthaine dans « La confusion des Sentiments » qui est certainement l’apogée du genre.
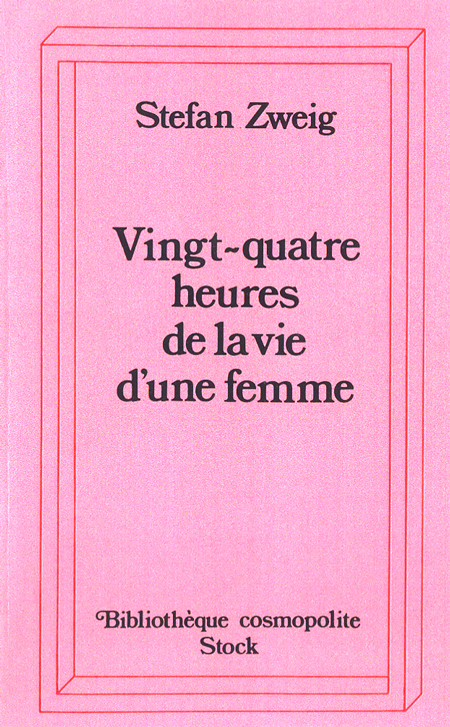
Mais ce qui à mon sens, et c’était aussi l’avis de Gogol, ce qui dépasse tout, est « Vingt quatre heures de la Vie d’une Femme », chef d’œuvre insurpassable qui en dépit d’une introduction exceptionnellement peu concise, se révèle un monument de pudeur, de finesse, de description de l’indescriptible. La compassion et l’horreur, l’ambivalence de la nature humaine, la difficulté de juger, l’emprise d’une passion fatale qui nous entraine malgré qu’on en aie et que l’on nomme vice (le tabac, l’alcool, le sexe, l’avarice, la manie du collectionneur, et autres obsessions menacées par des rechutes), ce quitte ou double entre la volonté et celle d’un double noir, tel est le sujet de ce roman. A lire absolument comme antidote à la barbarie ambiante.